Sur l’histoire
Dans le premier de trois extraits de L’œuvre des morts : une histoire culturelle des restes mortels, Thomas Laqueur explore la nécrobotanique de l’if, » l’arbre des morts » – que l’on retrouve dans les cimetières des églises du Royaume-Uni, de France et d’Espagne.

William Turner, Pope’s Villa at Twickenham, 1808.
Un cimetière était adjacent à une église ; tous deux abritaient les ossements des morts. Les trois – le bâtiment, le sol, les morts – étaient unis par une histoire commune qui les faisait faire partie de ce qui, au XVIIIe siècle, était une évidence ; s’il y avait un paysage organique, c’était bien le cimetière.
L’if européen à longue durée de vie – Taxus baccata, l’arbre des morts, l’arbre aux graines toxiques – témoigne de l’ancienneté du cimetière et fait de l’ombre à ses » ormes rugueux « , aux monticules et aux sillons de ses tombes : L’if de la légende est vieux et revendique une présence immémoriale. Nous parlons ici de deux ou trois douzaines de géants exemplaires, dont certains ont une circonférence de dix mètres, qui se dressent depuis 1 300 à 3 000 ans, mais aussi de nombreux arbres plus modestes et historiquement documentés qui ont vécu, et ont été commémorés, pendant des siècles. Aujourd’hui, au moins 250 ifs sont aussi vieux ou plus vieux que les cimetières dans lesquels ils se trouvent. Certains étaient là lorsque les premières églises saxonnes et même les premières églises chrétiennes britanniques en bois de hêtre ont été construites ; une charte du septième siècle de Péronne en Picardie parle de préserver l’if sur le site d’une nouvelle église.
L’ancienneté exacte d’un arbre donné est, et était, un sujet de controverse. Les estimations dépendaient de l’existence de deux ou plusieurs mesures de la circonférence sur une longue période, puis de l’application d’une formule qui projetait le taux de croissance dans le temps. Ces formules étaient à leur tour dérivées d’autres mesures en série – tant de pieds en tant d’années – complétées par des mesures de circonférence d’arbres dont l’âge était connu grâce à des preuves écrites. En fait, une datation précise est probablement impossible, et tout le monde l’a reconnu. Les variables qui déterminent le taux de croissance d’un arbre sont trop nombreuses pour qu’il soit possible d’établir un rapport fiable sur l’évolution de la circonférence par décennie. Mais personne ne remet en question le fait que les ifs vivent pendant des milliers d’années : « La plupart des arbres semblent plus vieux qu’ils ne le sont », déclare le dendrologue Alan Mitchell, « sauf les ifs qui sont encore plus vieux qu’ils ne le paraissent ». Ils font partie intégrante du cimetière depuis des temps immémoriaux. Ce sont des arbres du passé profond ; leur histoire se porte garante de l’ancienneté du paysage ecclésiastique.
L’antiquaire du XIXe siècle Daniel Rock spécule que l’if du cimetière d’Aldworth, dans le Berkshire, pourrait bien avoir été planté par les Saxons. John Evelyn, diariste et écrivain forestier du XVIIe siècle, a mesuré cet arbre ; Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), le célèbre botaniste suisse, l’a mesuré à nouveau un siècle plus tard et a utilisé la différence pour calculer les rapports âge/circonférence ; Rock lui-même l’a mesuré en 1841 et a noté qu’il avait gagné un yard de circonférence depuis qu’il avait été noté dans Beauties of England (1760). De nombreux autres ifs anciens de cimetière ont leur propre histoire bien documentée. Ce sont les célébrités de l’espèce qui donnent une voix à l’ancienneté du cimetière et de ses morts. Des milliers d’ifs ordinaires partagent l’aura de l’espèce.
C’est « sous l’ombre de l’if » que « s’élève le gazon en maints tas moisis », comme le dit l' »Elegy Written in a Country Churchyard » de Thomas Gray. Le Taxus baccata projette presque invariablement son ombre là où se trouvent les morts, sur les côtés sud et ouest de l’église. Comme les corps qu’il surveille, on le trouve rarement sur le côté nord, et seulement dans des circonstances exceptionnelles. Certains pensent, comme l’a suggéré Robert Turner, l’étrange, savant et prodigieux traducteur du XVIIe siècle de nombreux textes mystiques et médico-chimiques, que c’est parce que les branches des ifs « aspireraient et absorberaient » les « vapeurs grossières et oléagineuses exhalées des tombes par le soleil couchant ». Elles pourraient également empêcher l’apparition de fantômes ou d’apparitions. Les gaz non absorbés produisaient l’ignes fatui, le « feu stupide » comme celui que les voyageurs voyaient au-dessus des tourbières et des marais, et ceux-ci, dans le contexte des cimetières, pouvaient être confondus avec des cadavres qui marchaient. Les moines superstitieux, poursuit-il, croyaient que l’if pouvait chasser les démons. Ses racines, pensait-il, étaient toxiques parce qu’elles « courent et sucent la nourriture » des morts, dont la chair est « le plus mauvais poison qui soit ».
Mais les affirmations fantaisistes de Turner sur l’adaptation écologique de l’if sont un peu post hoc. La question plus fondamentale est de savoir pourquoi l’if était si intimement associé aux morts en premier lieu. Et, comme toutes les questions qui cherchent des débuts mythiques, il est impossible d’y répondre. Ou plutôt, elle a trop de réponses. L’if était sacré pour Hécate, la déesse grecque associée à la sorcellerie, à la mort et à la nécromancie. On disait qu’il purifiait les morts à leur entrée dans l’Hadès ; le poète Statius, du premier siècle de notre ère, souvent cité par les folkloristes du dix-neuvième siècle, raconte que le héros oraculaire Amphiaraus, frappé par la foudre de Zeus, fut arraché à la vie si rapidement que « la Furie ne l’avait pas encore rencontré et purifié avec une branche d’if, et Proserpine ne l’avait pas marqué sur le montant de la porte sombre comme admis dans la compagnie des morts ». Les druides associaient l’arbre aux rituels de mort. En fait, c’est la longue histoire païenne des arbres qui a poussé les dirigeants de la Contre-Réforme catholique à interdire complètement leur plantation et qui a motivé certains – un évêque de Rennes du début du XVIIe siècle est un cas célèbre – à essayer, sans succès face à l’opposition populaire, d’interdire l’if en particulier. Le clergé anglais post-réforme n’a pas fait de tels efforts. Les poètes des XVIe et XVIIe siècles nous racontent que la feuille d’if recouvrait les tombes et oignait les corps. Le fou Feste dans Twelfth Night chante son « linceul de blanc, tout collé d’ifs ». Tout cela était un lieu commun dans les histoires antiques. L’association de l’if avec l’histoire de la Passion du Christ, avec le mercredi des Cendres et le dimanche des Rameaux, l’était tout autant. Peu d’arbres étaient aussi enracinés dans le temps profond des morts.

John Burgess, Yews in a Country Churchyard.
Au début du XVIIIe siècle, un rival non chargé d’une longue histoire est apparu en Europe : le saule pleureur. Il est arrivé en Angleterre depuis la Chine via la Syrie parce qu’un marchand d’Alep nommé Thomas Vernon en a donné un à Peter Collinson, le plus important intermédiaire dans l’échange mondial de plantes. Ce dernier a ensuite donné le spécimen à Alexander Pope pour ses jardins de Twickenham au début des années 1720. Il existe des variantes de cette histoire : Vernon était le propriétaire de Pope et l’a peut-être donné directement à ce dernier ; il est possible qu’il soit apparu en Angleterre un peu plus tôt. Mais le saule pleureur était indéniablement nouveau et étranger au XVIIIe siècle, et les premiers saules pleureurs comme celui de Pope ont apprécié l’attention portée au nouvel arbre de la ville. Salix Babylonica Linnaeus l’a nommé ainsi, pensant à tort qu’il s’agissait de l’arbre des lamentations du psaume 137 : « Près des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis, oui, nous avons pleuré, quand nous nous sommes souvenus de Sion. / Nous avons suspendu nos harpes aux saules au milieu d’eux. » On peut lui pardonner son erreur. La taxonomie des saules est, comme nous le dit le principal expert, « déroutante ». Le véritable Salix babylonica est fragile dans les climats froids et pourrait bien avoir disparu, de sorte que notre saule pleureur moderne est l’un de ses cultivars, Salix × sepulcralis, produit par croisement avec le saule blanc européen, Salix alba.
Le saule pleure et se morfond peut-être à cause de ses feuilles tombantes ou parce qu’il a été appelé à tort l’arbre des lamentations des anciens Hébreux. Mais quelle que soit la façon dont il a obtenu son nom et quelle que soit sa généalogie précise, il est l’opposé horticole du Taxus baccata : à racines superficielles, de courte durée et sans bagage historique jusqu’à ce qu’Alexander Pope le rende célèbre. Sa villa a été démolie en 1808, pas un siècle après l’arrivée du saule pleureur, car le nouveau propriétaire en avait assez des touristes. Le peintre J. M. W. Turner a peint ses ruines et a vu le fameux arbre, devenu un tronc mourant, et a écrit à son sujet :
Le saule de Pope pliant vers la terre a oublié
Save one weak scion by my fostering care
Nursed into life which fell on bracken spare
On the lone Bank to mark the spot with pride.
Des dizaines de milliers de scions ont été envoyés de Twickenham avant la triste fin de l’arbre de Pope.
Des images de Salix babylonica ou peut-être de Salix × sepulcralis, le saule funèbre, ornaient les nouvelles annonces commerciales de funérailles et les souvenirs de deuil des XVIIIe et XIXe siècles ; il ombrageait la tombe de Rousseau à Ermenonville. La tristesse, pensait John Claudius Loudon, le plus éminent horticulteur du XIXe siècle, était l’expression naturelle de l’if, la mélancolie celle du saule pleureur. Ses branches tombantes en faisaient un signe naturel de tristesse. En un siècle, l’étranger sans histoire est devenu l’arbre emblématique des cimetières-parcs du XIXe siècle. C’était l’arbre non pas des morts immémoriaux mais du deuil, un arbre non pas pour les âges mais pour les trois générations pour lesquelles les morts peuvent espérer qu’on se souvienne d’eux.
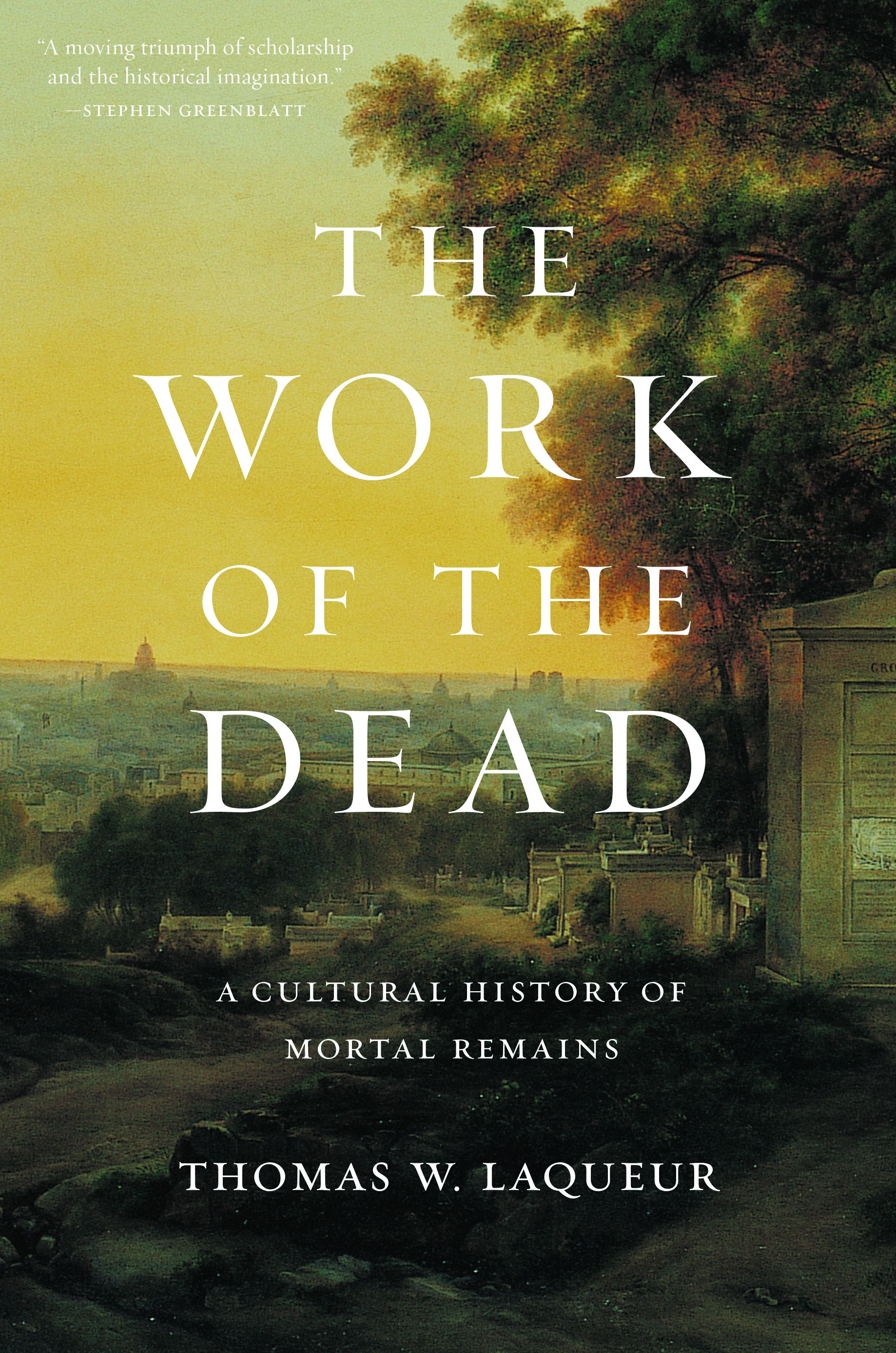 Thomas W. Laqueur est professeur d’histoire Helen Fawcett à l’université de Californie, Berkeley. Il a notamment publié Making Sex : Body and Gender from the Greeks to Freud et Solitary Sex : A Cultural History of Masturbation. Il collabore régulièrement à la London Review of Books.
Thomas W. Laqueur est professeur d’histoire Helen Fawcett à l’université de Californie, Berkeley. Il a notamment publié Making Sex : Body and Gender from the Greeks to Freud et Solitary Sex : A Cultural History of Masturbation. Il collabore régulièrement à la London Review of Books.